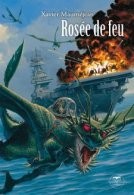 1944. Le Japon met en oeuvre la stratégie de la dernière chance, celle des attaques suicides défendue par le capitaine Obayashi. Tatsuo Hanada, lui, escorte les pilotes volontaires. Son petit frère, Hideo, vit le quotidien des civils en temps de guerre.
1944. Le Japon met en oeuvre la stratégie de la dernière chance, celle des attaques suicides défendue par le capitaine Obayashi. Tatsuo Hanada, lui, escorte les pilotes volontaires. Son petit frère, Hideo, vit le quotidien des civils en temps de guerre.
Rosée de feu est un roman pour le moins étonnant, un de ces drôles de mélanges dont Xavier Mauméjean est coutumier. C'est un roman historique, sans aucun conteste, au regard de la réalité des événements rapportés, mais un roman historique porté par des dragons qui n'ont rien en commun ou presque avec leurs frères de fantasy et porté par une écriture sèche, presque clinique qui écarte soigneusement toute sensationnalisme. e l'avoue, au départ, cette sobriété m'a un peu refroidie. Puis j'ai été gagnée par le cheminement vers l'inéluctable, la tension qui empreint le récit. La postface qui permet de mieux appréhender la construction du récit et l'alternance des voix, hommage à un art japonais et aux éléments de la pensée chinoise m'a permis, après coup, d'avoir un éclairage différent sur ce que je venais de lire, de l'ancrer un peu plus dans "l'esprit" japonais.
Trois personnages principaux, trois points de vues permettent de découvrir le Japon en guerre: celui d'un enfant de six ans dont l'innocence ne résiste pas à la découverte de la réalité des adultes, celui d'un jeune homme de vingt ans usé par les combats, celui d'un gradé prêt à tout pour que l'espoir du Japon ne meurt pas. Importance de la tradition martiale, place de l'empereur, affrontements politiques et stratégiques, endoctrinement, propagande, nationalisme, patriotisme, le tableau est complet et fin, ne jugeant à aucun moment mais exposant des fait affrontés à une culture et une société accrochée à ses traditions, donnant par là des éléments de compréhension de l'attitude du peuple japonais pendant la guerre. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est d'aborder la guerre du "mauvais côté". On dépasse les témoignages de guerres, le plus souvent ceux des vainqueurs, l'imagerie de guerre comme celle portée par des romans, des films, ou des bandes dessinées comme Buck Danny pour aborder la guerre côté japonais, la complexité des derniers mois du conflit et du phénomène des kamikazes bien moins simple que ce qu'on a pu en imaginer.
La sobriété du ton rend d'autant plus terrible l'horreur de la guerre. Nul besoin d'en rajouter, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la description des dégats aussi, des résultats des frappes du Shimbu sur les navires américains à la prise de Nankin en passant par la destruction de Tokyo et les batailles terrestres. Quand à l'impact des citations d'époque, il en est renforcé. Le plus déstabilisant, ceci dit est le mélange des faits et de ces dragons qui induisent une sorte de distorsion. On est dans le réel, le vrai (dans la mesure ou l'histoire est "vraie", mais je ne vais pas me lancer dans une longue digression sur la vérité et la fiabilité en histoire, quoi que, ça aurait sans doute été moins long que cette parenthèse que, rassurez-vous, je vais refermer), mais pas tout à fait. Les chasseurs, avions de reconnaissance et autres bombardiers sont remplacés par des dragons qui ont des caractéristiques "techniques", un personnel attaché à leur entretien, un peu comme des machines, mais organiques, un peu comme les chevaux et autres animaux utilisés pendant les guerres jusqu'en 1918. Ce sont des animaux, présents dans les plus anciennes légendes, mais des animaux qu'on élève et avec lesquels les pilotes ont des relations qui ressemblent un peu à celle qu'un cavalier pourrait avoir avec un cheval.
Je m'arrête là. Vous aurez compris que je conseille chaudement: aux amateurs d'histoire, à ceux de science-fiction et à tous ceux qui aiment qu'on les secoue.
Mauméjean, Xavier, Rosée de feu, Le Bélial, 2010, 263p, 4.5/5
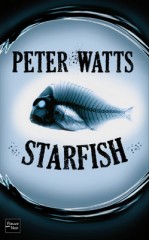 Lenie Clarke et ses compagnons ne sont pas plongeurs, peu d'entre eux sont des scientifiques et pourtant, ils vont se retrouver pendant un an à plus de 700 mètre de profondeur. Leur travail, entretenir les installations qui permettent d'utiliser l'énergie phénomènale dégagée par le jeu de la tectonique des plaques. Leur compétence, être capable de s'adapter à cet endroit. Mais quand on réunit au fond de l'océan des psychotiques, garder le contrôle de la situation est un voeu pieu. Surtout quand une apocalypse se dessine à l'horizon.
Lenie Clarke et ses compagnons ne sont pas plongeurs, peu d'entre eux sont des scientifiques et pourtant, ils vont se retrouver pendant un an à plus de 700 mètre de profondeur. Leur travail, entretenir les installations qui permettent d'utiliser l'énergie phénomènale dégagée par le jeu de la tectonique des plaques. Leur compétence, être capable de s'adapter à cet endroit. Mais quand on réunit au fond de l'océan des psychotiques, garder le contrôle de la situation est un voeu pieu. Surtout quand une apocalypse se dessine à l'horizon.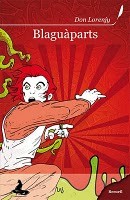 "Top, c'est parti. Je suis un recueil de seize nouvelles où la réalité est mise à mal, où le futur comme le passé se prennent quelques séries de baffes monumentales. Je voyage dans l'espace sous forme de cube, sous forme de navette déglinguée, j'ai des potes commandos des frontières de l'infini, d'autres qui ont le tentacule facile. J'aime les enfants, j'aime pas les hôpitaux, j'entends des voix, je chante le Canto-pilote électrique. Quand j'ai créé le monde j'étais un concept, quand je l'ai vu disparaitre j'avais des cors aux pieds. Je suis ... Je suis ...
"Top, c'est parti. Je suis un recueil de seize nouvelles où la réalité est mise à mal, où le futur comme le passé se prennent quelques séries de baffes monumentales. Je voyage dans l'espace sous forme de cube, sous forme de navette déglinguée, j'ai des potes commandos des frontières de l'infini, d'autres qui ont le tentacule facile. J'aime les enfants, j'aime pas les hôpitaux, j'entends des voix, je chante le Canto-pilote électrique. Quand j'ai créé le monde j'étais un concept, quand je l'ai vu disparaitre j'avais des cors aux pieds. Je suis ... Je suis ...

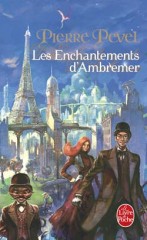 Paris, 1909. Les messieurs portent la redingote, les dames des jupons, les voitures sont encore objet rare. Rien d'inhabituel si on oublie une tour Eiffel en bois blanc et un étrange château dans le lointain du bois de Boulogne. Celui d'Ambremer. Car les fées ont décidé de dévoiler aux hommes l'existence de l'OutreMonde, et nulle part ailleurs qu'à Paris, la féerie n'est aussi présente. Dans la vie comme dans la mort: une étrange série de meurtres défraie la chronique, meurtres sur lesquels Louis Denizart Hippolyte Griffont, mage du Cercle Cyan de son état, est chargé d'enquêter et qui vont le mener au coeur de dangers dont le moindre n'est pas Isabel de Saint-Gil, fée rénégate avec laquelle il est contraint de faire équipe. Notre magicien n'est pas au bout de ses peines...
Paris, 1909. Les messieurs portent la redingote, les dames des jupons, les voitures sont encore objet rare. Rien d'inhabituel si on oublie une tour Eiffel en bois blanc et un étrange château dans le lointain du bois de Boulogne. Celui d'Ambremer. Car les fées ont décidé de dévoiler aux hommes l'existence de l'OutreMonde, et nulle part ailleurs qu'à Paris, la féerie n'est aussi présente. Dans la vie comme dans la mort: une étrange série de meurtres défraie la chronique, meurtres sur lesquels Louis Denizart Hippolyte Griffont, mage du Cercle Cyan de son état, est chargé d'enquêter et qui vont le mener au coeur de dangers dont le moindre n'est pas Isabel de Saint-Gil, fée rénégate avec laquelle il est contraint de faire équipe. Notre magicien n'est pas au bout de ses peines...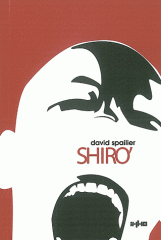 Le fond était pourtant intéressant: dans un monde dont on ne sait guère à quel point il est proche, deux enfants, Elliott et Daisy, enfermés depuis leur naissance dans des chambres hermétiques d'un centre sont l'objet d'expériences mystérieuses dirigées par le docteur Wilson Willard, ancien enfant du centre. Petit à petit, va se dessiner un univers qui a vu l'avénement d'une intelligence artificielle forte et d'où l'humain a disparu totalement. Un univers où la gigalopole de Tokyozaki s'élève vertigineusement et où les machines s'efforcent de recréer l'humain, de régresser de la perfection de la machine pensante aux émotions de chair, de sang et de pensée. Eliott et Daisy sont deux expériences prometteuses. Deux expériences qui vont peu à peu devenir des grains de sable vite broyés par l'univers dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de choses de Shiro, et notamment une réflexion passionnante sur ce qu'est l'humain à travers trois personnages qui ne sont plus tout à fait des machines, mais pas encore des êtres humains et qui vont se heurter aux murs d'une identité qu'on ne leur laisse pas découvrir. L'humanité, Elliott, Daisy et même leur démiurge, ne la connaissent que par les vestiges d'émissions de télévision et de films. Il la découvre aussi dans les doutes, les colères, la volonté de liberté ou la peur qu'ils ressentent, l'anoisse qu'ils cherchent, chacun à leur manière de calmer. Il s'y heurtent faute de pouvoir l'exprimer dans un monde où, si l'on cherche à revenir à l'organique, la logique stricte et froide du langage binaire est incapable de comprendre et de ne pas perçevoir comme une menace la différence qu'ils représentent. David Spailier raconte ainsi l'histoire de trois freaks dans un monde de machine qui les rejette. J'ai aimé l'idée de ce point de vue inversé: au lieu de machines évoluant dans un monde d'humains, ce sont des presque humains qui évoluent dans un monde de machine. Une autre manière d'envisager la matrice remise au goût du jour il y a quelques années.
Le fond était pourtant intéressant: dans un monde dont on ne sait guère à quel point il est proche, deux enfants, Elliott et Daisy, enfermés depuis leur naissance dans des chambres hermétiques d'un centre sont l'objet d'expériences mystérieuses dirigées par le docteur Wilson Willard, ancien enfant du centre. Petit à petit, va se dessiner un univers qui a vu l'avénement d'une intelligence artificielle forte et d'où l'humain a disparu totalement. Un univers où la gigalopole de Tokyozaki s'élève vertigineusement et où les machines s'efforcent de recréer l'humain, de régresser de la perfection de la machine pensante aux émotions de chair, de sang et de pensée. Eliott et Daisy sont deux expériences prometteuses. Deux expériences qui vont peu à peu devenir des grains de sable vite broyés par l'univers dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de choses de Shiro, et notamment une réflexion passionnante sur ce qu'est l'humain à travers trois personnages qui ne sont plus tout à fait des machines, mais pas encore des êtres humains et qui vont se heurter aux murs d'une identité qu'on ne leur laisse pas découvrir. L'humanité, Elliott, Daisy et même leur démiurge, ne la connaissent que par les vestiges d'émissions de télévision et de films. Il la découvre aussi dans les doutes, les colères, la volonté de liberté ou la peur qu'ils ressentent, l'anoisse qu'ils cherchent, chacun à leur manière de calmer. Il s'y heurtent faute de pouvoir l'exprimer dans un monde où, si l'on cherche à revenir à l'organique, la logique stricte et froide du langage binaire est incapable de comprendre et de ne pas perçevoir comme une menace la différence qu'ils représentent. David Spailier raconte ainsi l'histoire de trois freaks dans un monde de machine qui les rejette. J'ai aimé l'idée de ce point de vue inversé: au lieu de machines évoluant dans un monde d'humains, ce sont des presque humains qui évoluent dans un monde de machine. Une autre manière d'envisager la matrice remise au goût du jour il y a quelques années.