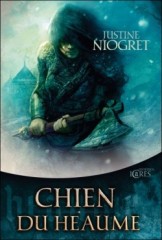Parler d'un roman d'Henry Bauchau m'effraie toujours. Comme traduire l'émerveillement qui me saisit toujours, l'impact physique qu'a chacune de ses oeuvres sur moi, le souffle qui manque parfois et le sentiment de plénitude à la dernière page. Ses récits sont à la fois d'une extrême simplicité et d'une complexité symbolique qui fait de la lecture une exercice fluide et pourtant épuisant.
Dieu que je l'aime cette plume, je l'aime d'autant plus que je la sais fragilisée par l'âge: Henry Bauchau a 97 ans et continue un travail essentiel et fascinant avec un talent et une force qui ne perdent pas leur intensité.
Une des choses qui m'a fascinée dès le départ a été la place qu'il donne dans son oeuvre à l'art. A la fois facteur d'équilibre, de déséquilibre, moteur fondamental de la construction de soi, de la survie, enchantement du monde et souffrance. Mais je n'avais pas encore lu L'enfant bleu. Ni Déluge, son dernier roman. Deux romans où l'art et la pratique artistiques ont une place centrale, absolue et qui, d'une certaine manière, sont le prolongement l'un de l'autre.
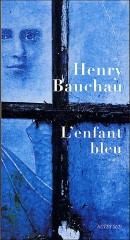 L'enfant bleu d'abord. L'histoire d'Orion, un adolescent psychotique que personne ne parvient à réellement prendre en charge jusqu'à Véronique, une psychanalyste qui lui fait trouver le chemin de l'art, un chemin qui va changer son rapport au monde et lui permettre de vivre avec le démon de Paris qui l'attaque dès que la situation dans laquelle il se trouve lui est insupportable.
L'enfant bleu d'abord. L'histoire d'Orion, un adolescent psychotique que personne ne parvient à réellement prendre en charge jusqu'à Véronique, une psychanalyste qui lui fait trouver le chemin de l'art, un chemin qui va changer son rapport au monde et lui permettre de vivre avec le démon de Paris qui l'attaque dès que la situation dans laquelle il se trouve lui est insupportable.
L'enfant bleu est un roman sur l'art mais il surtout sur une rencontre: celle de Véronique et d'Orion, celle du monde des "normaux", des "soignants" avec le peuple du désastre. Ces enfants et ces adultes incapables de faire face au monde et à la société dans laquelle ils sont supposés vivre. Ceux qui font peur, ceux qu'on rejette aux marges, à qui on essaie parfois de donner une place, si rarement adapté à ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent. Henri Bauchau donne une voix à ce peuple à travers Orion et ses crises terribles qui le poussent à détruire parce que le monde est trop angoissant, trop incompréhensible. C'est un personnage tragique: à la fois insupportable, terrifiant, poignant. Il sait qu'il est malade, différent des autres et incapable d'affronter cette différence parce que personne n'est présent pour l'aider à le faire tout simplement parce que personne ne sait comment faire, comment l'épauler pour qu'il vive enfin. Et puis il y a Véronique au parcours chaotique, Véronique qui se débat dans une vie compliquée et qui s'attache à Orion, d'abord son patient puis tellement plus que ça. On les suit tous les deux sur le long chemin qu'ils empruntent, fait de progrès, de régressions, de doutes, d'angoisses, mais qui mène vers l'espoir d'une vie rendue meilleure. Et quand Orion passe enfin du "On ne sait pas" au Je, on ressent la joie et la peine de Véronique. J'ai aimé ce personnage, à la fois immensément fragile et suffisamment fort pour se battre contre la grisaille du quotidien, la peur, pour trouver la beauté dans les petits événements, dans les poèmes qu'elle parvient de nouveau à écrire grâce ou à cause d'Orion qui la confronte à un nouveau rapport au monde, dans la musique de Vasco, son homme, qui se trouve lui aussi au fil des pages. A chaque personnage son art et sa manière d'affronter le monde pour parvenir au coeur de lui-même et à l'équilibre. J'ai aimé ces parcours de vie, même si parfois Vasco ou Véronique m'ont agaçé, même si le petit monde des artistes a quelque chose d'un microcosme parfois verbeux et égocentré. Parce que finalement, avec leur art, ils réenchantent un monde routinier, dévoreur, dont la grisaille et les failles avalent le bonheur d'être et jusqu'à la souffrance. L'art est à la fois don, fardeau et catharsis qui permet de s'ouvrir au monde et aux autres.
On sent au fil des pages l'expérience d'Henri Bauchau, devenu, un peu comme Véronique psychanalyste au bout d'un long chemin. C'est sans doute grâce à cette expérience qu'il parvient à rendre Orion si vivant, si crédible dans cette parole lourde de souffrance et naîve, inventive et violente, chambardifiée. C'est aussi par cette expérience qu'il fait découvrir ce que peut être le dialogue du psychanalyse et de son patient, ses dangers, l'espoir non pas de guérir les blessures, mais de parvenir à vivre avec et à en faire une part de soi qui participe du bonheur. C'est fascinant et passionnant. Et c'est beau. Parce que Henri Bauchau sait décrire l'art, sa puissance, son expressivité, la brûlure qu'il représente, la peur qu'il provoque chez ceux qui portent une oeuvre en eux, l'incompréhension ou la passion de ceux qui voient, entendent ou touchent. Parce qu'il sait aussi, aimer ses personnages, les faire s'aimer et nous les faire aimer.
 Déluge est le miroir de L'enfant bleu. Il y avait Orion, il y a Florian, le peintre fou et pyromane dont l'habitude de brûler ses oeuvres répond à cet acte accomplit par Orion et auquel on pense forcément. Florian, c'est un peu Orion, un Orion qui aurait vieilli, dont l'art aurait connu succès et reconnaissance, qui rencontrerait sur sa route une jeune femme à sauver comme lui avait été sauvé par une femme, celle qui avait su l'écouter et l'amener à trouver dans la peinture un exutoire. Cette jeune femme c'est Florence, qui a abandonné une carrière universitaire prometteuse pour partir se soigner, et surtout se trouver et se construire elle qui n'avait fait que suivre le chemin tracé par sa mère vers le succès et la reconnaissance sociale. C'est sur les docks d'un port du Sud de la France que leurs chemins vont se croiser et s'entremêler sans qu'on sache bien qui soutient qui dans cette collaboration qui les ménera tous les deux et leur entourage avec eux vers la grande oeuvre de Florian.
Déluge est le miroir de L'enfant bleu. Il y avait Orion, il y a Florian, le peintre fou et pyromane dont l'habitude de brûler ses oeuvres répond à cet acte accomplit par Orion et auquel on pense forcément. Florian, c'est un peu Orion, un Orion qui aurait vieilli, dont l'art aurait connu succès et reconnaissance, qui rencontrerait sur sa route une jeune femme à sauver comme lui avait été sauvé par une femme, celle qui avait su l'écouter et l'amener à trouver dans la peinture un exutoire. Cette jeune femme c'est Florence, qui a abandonné une carrière universitaire prometteuse pour partir se soigner, et surtout se trouver et se construire elle qui n'avait fait que suivre le chemin tracé par sa mère vers le succès et la reconnaissance sociale. C'est sur les docks d'un port du Sud de la France que leurs chemins vont se croiser et s'entremêler sans qu'on sache bien qui soutient qui dans cette collaboration qui les ménera tous les deux et leur entourage avec eux vers la grande oeuvre de Florian.
On retrouve dans Déluge les thèmes de L'enfant bleu, l'écriture sèche et concise qui parvient si bien à emporter le lecteur dans l'intensité d'un récit qui atteint le coeur de l'humain. C'est de folie qu'il s'agit, de la folie du monde, de celle d'individus dont le combat quotidien est de vivre dans ce monde dont ils sont exclus par leur différences, ou dans lequel ils ne parviennent plus à respirer. Henry Bauchau raconte une nouvelle fois la rencontre de ceux qui sont cassés, l'amour qui les lie et les sauve, l'art qui leur permet de jeter à la face du monde leur souffrance, de la mettre en image, qui guérit parce qu'il panse les blessures de l'âme. On plonge profondément dans la psyché des personnages et c'est en même temps pudique. Plus encore que dans L'enfant bleu, Henry Bauchau va au coeur de l'acte même de la création, de la force avec laquel il s'impose à l'individu. On voit Florian et Florence se perdre, se retrouver au gré des scènes de cet immense tableau qu'ils peignent, on voit comment chacun influence l'autre, comment l'attraction qu'exerce Florian fait naître une petite communauté soudée, magnifique de gens perdus et aimants qui trouvent avec les autres l'équilibre qui manquait à leur vie.
Pour moi, ces deux romans se répondent, et affirment, chacun avec sa voix, l'importance de l'art dans une vie d'homme, sa force et le pouvoir qu'il a de construire, d'étayer une existence, comme de la détruire. Henry Bauchau dit tout cela avec un talent qui ne se dément jamais et un ton unique qui fait oublier très vite les quelques défauts qu'on pourrait trouver à ses oeuvres, les petits agaçements qui ne manquent pas face à des personnages qui ont une telle présence. Surtout, surtout, Henry Bauchau donne corps et voix aux différents, aux pas-comme-les-autres avec un respect et un amour qui forcent l'admiration et font de ces deux romans, si ce n'est de son oeuvre, une ouverture sur le monde proprement indispensable.
Erzébeth a accepté de faire billet commun! Pour Déluge, c'est par là!
Bauchau, Henry, L'enfant bleu, Actes Sud, 2006, 442 p., 5/5
Bauchau, Henry, Déluge, Actes Sud, 2010, 169 p., 5/5
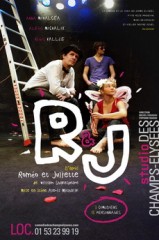 R&J donc. Une pièce absolument hilarante, jubilatoire, excessive, tragique, enthousiasmante, je vous fait grâce du reste des qualificatifs qui traversent mon esprit encore en surchauffe. Il faut dire que c’est du sacrément bon boulot. Trois acteurs, 15 personnages, quelques coupes dans le texte, une ou deux chansons, des vannes à hurler de rire, des combats au canif, un DJ nain, une nourrice cocasse, un Tybald aux lunettes apocalyptiques, un parrain Montaigu à canne et accent sicilien, le tout dans un décor minimaliste constitué par trois portants à costume, quelques guirlandes de fleur, des façades en carton. Ca fonctionne et ça fonctionne très, très bien les 3 acteurs déployant une énergie phénoménale et passant d’un rôle à un autre avec un talent époustouflant. Mention spéciale d’ailleurs à Anna Mahalcea qui, passant d’un Mercutio survolté et gouailleur à une Juliette naïve et habitée par l’amour est superbe. Quand à ses deux compères… Non content de jouer superbement, ils provoquent certains effets… du genre asphyxie mentale, couinement intérieur, glapissement digne et discret,... Je ne nierai pas avoir eu un léger, oh, très léger moment de flottement… Surtout quand Roméo se radine torse nu. Mais en toute dignité.
R&J donc. Une pièce absolument hilarante, jubilatoire, excessive, tragique, enthousiasmante, je vous fait grâce du reste des qualificatifs qui traversent mon esprit encore en surchauffe. Il faut dire que c’est du sacrément bon boulot. Trois acteurs, 15 personnages, quelques coupes dans le texte, une ou deux chansons, des vannes à hurler de rire, des combats au canif, un DJ nain, une nourrice cocasse, un Tybald aux lunettes apocalyptiques, un parrain Montaigu à canne et accent sicilien, le tout dans un décor minimaliste constitué par trois portants à costume, quelques guirlandes de fleur, des façades en carton. Ca fonctionne et ça fonctionne très, très bien les 3 acteurs déployant une énergie phénoménale et passant d’un rôle à un autre avec un talent époustouflant. Mention spéciale d’ailleurs à Anna Mahalcea qui, passant d’un Mercutio survolté et gouailleur à une Juliette naïve et habitée par l’amour est superbe. Quand à ses deux compères… Non content de jouer superbement, ils provoquent certains effets… du genre asphyxie mentale, couinement intérieur, glapissement digne et discret,... Je ne nierai pas avoir eu un léger, oh, très léger moment de flottement… Surtout quand Roméo se radine torse nu. Mais en toute dignité.
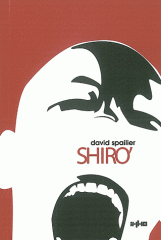 Le fond était pourtant intéressant: dans un monde dont on ne sait guère à quel point il est proche, deux enfants, Elliott et Daisy, enfermés depuis leur naissance dans des chambres hermétiques d'un centre sont l'objet d'expériences mystérieuses dirigées par le docteur Wilson Willard, ancien enfant du centre. Petit à petit, va se dessiner un univers qui a vu l'avénement d'une intelligence artificielle forte et d'où l'humain a disparu totalement. Un univers où la gigalopole de Tokyozaki s'élève vertigineusement et où les machines s'efforcent de recréer l'humain, de régresser de la perfection de la machine pensante aux émotions de chair, de sang et de pensée. Eliott et Daisy sont deux expériences prometteuses. Deux expériences qui vont peu à peu devenir des grains de sable vite broyés par l'univers dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de choses de Shiro, et notamment une réflexion passionnante sur ce qu'est l'humain à travers trois personnages qui ne sont plus tout à fait des machines, mais pas encore des êtres humains et qui vont se heurter aux murs d'une identité qu'on ne leur laisse pas découvrir. L'humanité, Elliott, Daisy et même leur démiurge, ne la connaissent que par les vestiges d'émissions de télévision et de films. Il la découvre aussi dans les doutes, les colères, la volonté de liberté ou la peur qu'ils ressentent, l'anoisse qu'ils cherchent, chacun à leur manière de calmer. Il s'y heurtent faute de pouvoir l'exprimer dans un monde où, si l'on cherche à revenir à l'organique, la logique stricte et froide du langage binaire est incapable de comprendre et de ne pas perçevoir comme une menace la différence qu'ils représentent. David Spailier raconte ainsi l'histoire de trois freaks dans un monde de machine qui les rejette. J'ai aimé l'idée de ce point de vue inversé: au lieu de machines évoluant dans un monde d'humains, ce sont des presque humains qui évoluent dans un monde de machine. Une autre manière d'envisager la matrice remise au goût du jour il y a quelques années.
Le fond était pourtant intéressant: dans un monde dont on ne sait guère à quel point il est proche, deux enfants, Elliott et Daisy, enfermés depuis leur naissance dans des chambres hermétiques d'un centre sont l'objet d'expériences mystérieuses dirigées par le docteur Wilson Willard, ancien enfant du centre. Petit à petit, va se dessiner un univers qui a vu l'avénement d'une intelligence artificielle forte et d'où l'humain a disparu totalement. Un univers où la gigalopole de Tokyozaki s'élève vertigineusement et où les machines s'efforcent de recréer l'humain, de régresser de la perfection de la machine pensante aux émotions de chair, de sang et de pensée. Eliott et Daisy sont deux expériences prometteuses. Deux expériences qui vont peu à peu devenir des grains de sable vite broyés par l'univers dans lequel ils évoluent. Il y a beaucoup de choses de Shiro, et notamment une réflexion passionnante sur ce qu'est l'humain à travers trois personnages qui ne sont plus tout à fait des machines, mais pas encore des êtres humains et qui vont se heurter aux murs d'une identité qu'on ne leur laisse pas découvrir. L'humanité, Elliott, Daisy et même leur démiurge, ne la connaissent que par les vestiges d'émissions de télévision et de films. Il la découvre aussi dans les doutes, les colères, la volonté de liberté ou la peur qu'ils ressentent, l'anoisse qu'ils cherchent, chacun à leur manière de calmer. Il s'y heurtent faute de pouvoir l'exprimer dans un monde où, si l'on cherche à revenir à l'organique, la logique stricte et froide du langage binaire est incapable de comprendre et de ne pas perçevoir comme une menace la différence qu'ils représentent. David Spailier raconte ainsi l'histoire de trois freaks dans un monde de machine qui les rejette. J'ai aimé l'idée de ce point de vue inversé: au lieu de machines évoluant dans un monde d'humains, ce sont des presque humains qui évoluent dans un monde de machine. Une autre manière d'envisager la matrice remise au goût du jour il y a quelques années.