
C'est de sa faute si je suis restée silencieuse ces derniers jours! Oui, à lui là, l'affreux! Résumons un brin. Les parents de Dylan, respectivement hippie et artiste, plus blancs que blancs choissisent de s'installer dans les années 70 en plein coeur des quartiers noirs de Brooklyn. Bien évidemment, leur fiston va voir son enfance et son âge adulte fortement influencés par cette décision pas forcément heureuse pour lui. Il va pourtant pousser, vaille que vaille, accompagé de son ami métis Mingus, fils d'une star sur le retour et de paumés divers, blancs ou noirs. J'avais été fortement attirée par les critiques qui avaient été faites de ce roman à sa sortie. Je me suis donc jetée dessus quand, ô bonheur, j'ai enfin mis la main dessus à la bibliothèque.
Je ne peux pas dire que je sois totalement déçue. Je l'ai fini après tout... Mais péniblement, en alternant ennui profond et regain d'intérêt. Les thèmes abordés sont pourtant intéressants: fossé social et culturel, racisme ordinaire des blancs envers les noirs et des noirs envers les blancs, création, drogue. La solitude et le désespoir des personnages au demeurant souvent très beaux marquent tout le roman. Tous se retrouvent sur une voie sans retour, sans espoir. L'étude sociale est plutôt fine. J'ai beaucoup aimé les passages parlant de la culture du graph. Les références musicales sont bluffantes. C'est une histoire très violente, très crue, traversée par de véritables moments de grâce. Mais pas suffisant pour que je sois vraiment accrochée...
Jonathan Lethem, Forteresse de solitude, Ed. de l'Oliver, 2006, 677 p.

Autre lecture, dépaysement complet, violence aussi. Mais plus larvée. Takashi Aoki et Yuko Tanabe s'aiment. Ils veulent se marier. Mais voilà, dans le Japon de la fin du XXe siècle, l'argent et le pouvoir peuvent tout, et surtout briser les individus. Malgré le trèfle sous le signe duquel se place leur rencontre, ce signe de chance, ils vont avoir à faire face au pire. Sous la douceur et le détachement de l'écriture, c'est l'aliénation de l'individu, la quasi féodalité du monde du travail japonais qui sont décrits. Le piège se referme petit à petit sur les deux personnages principaux qui croient à un libre arbitre qui, de fait, leur échappe. Cela semble énorme au lecteur occidental mais recouvre sans aucun doute une réalité. Moins violent à première vue qu'un Ryu Murakami, mais je n'en suis pas sortie indemne. Et je vais poursuivre ma découverte de cet auteur.
Aki Shimazaki, Mitsuba, Lémac/Actes Sud, 2006, 156 p.
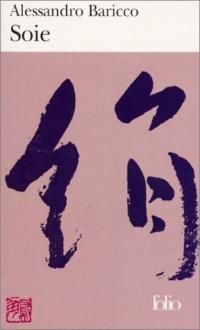
 Non, il ne s'agit plus du drame du LCA. En fait, j'ai fait une tentative de désherbage de ma bibliothèque personnelle. Bien sûr, ça n'a pas marché, mais j'ai retrouvé au hasard des étagères La Princesse de Clève. Et à force de le feuilleter, j'ai fini par le relire. Bon, il faut dire que les souvenirs que j'en gardais, dix années s'étant passées étaient flous, et que finalement, c'est comme si je l'avais lu pour la première fois.
Non, il ne s'agit plus du drame du LCA. En fait, j'ai fait une tentative de désherbage de ma bibliothèque personnelle. Bien sûr, ça n'a pas marché, mais j'ai retrouvé au hasard des étagères La Princesse de Clève. Et à force de le feuilleter, j'ai fini par le relire. Bon, il faut dire que les souvenirs que j'en gardais, dix années s'étant passées étaient flous, et que finalement, c'est comme si je l'avais lu pour la première fois.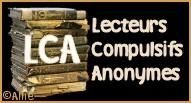
 Je pense que je vais maudire ceux qui m'ont lancée sur Twentieth century boys. Bon, ce n'est pas du Murakami, mais c'est très bon aussi dans une autre catégorie!
Je pense que je vais maudire ceux qui m'ont lancée sur Twentieth century boys. Bon, ce n'est pas du Murakami, mais c'est très bon aussi dans une autre catégorie!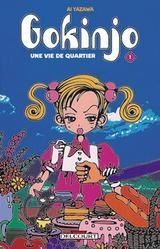 La suite ne concerne pas la fin des temps cette fois-ci, mais la fin de l'enfance. Ai Yazawa nous donne à lire un joli shojô avec Gokinjo. Bête histoire d'amour entre deux amis d'enfance, très tendre, très mignon et très bon pour le moral. Je suis fan.
La suite ne concerne pas la fin des temps cette fois-ci, mais la fin de l'enfance. Ai Yazawa nous donne à lire un joli shojô avec Gokinjo. Bête histoire d'amour entre deux amis d'enfance, très tendre, très mignon et très bon pour le moral. Je suis fan.