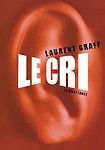Juette est née en 1158 à Huy, petite ville commerçante de l’actuelle Belgique. Rêveuse, solitaire, torturée, cette enfant de 13 ans est mariée comme le veut la coutume. Mais pour elle qui s’interroge, qui réfléchit, qui s’accroche à son enfance, ce mariage est une mort lente, une violence qui la mènera, une fois veuve au rejet de l’Eglise, du mariage et du monde.
Même son unique ami, le moine Hughes de Floreffe ne pourra la retenir.
Clara Dupont-Monod offre avec La passion selon Juette un très beau portrait de femme, et une belle approche de cette période de l’histoire médiévale où sont nés les courants mystiques et les hérésies.
C’est un roman violent, âpre. Le destin de Juette n’est pas celui de toutes les femmes. Dès l’enfance elle est singulière. Sa maigreur, son intelligence, ses questions la mettent à l’écart des autres femmes qui acceptent le mariage, les lois de l’Eglise et des prêtres. Elles la mettent à l’écart du monde des hommes. Très tôt, elle va percevoir l’injustice d’un monde dans lequel les prêtres s’enrichissent, couchent avec leurs fidèles, où les hommes s’enrichissent aux dépendes des autres et où les femmes sont cantonnées à une obéissance servile. Juette est une femme dangereuse à une époque où il ne fait pas bon dévier de la norme et du dogme catholique. Plus qu’une mystique, qu’une hérétique ou une folle, c’est une femme passionnée, en révolte contre les injustices de son temps, en révolte contre les hommes. Clara Dupont-Monod réussi la performance de rester juste. La quatrième de couverture présente Juette comme « peut-être l’une des premières féministes ». J’ai eu un peu peur, mais j’ai retrouvé dans les mots de Juette, dans son rejet des hommes bien des choses lues dans les Dames du XIIe siècle de Georges Duby : la soumission, les règles du mariage, les premières mystiques, le refuge des femmes refusant le mariage dans les ordres religieux et laïcs. Juette exècre les prêtres, les hommes, son époux, la sexualité et les grossesses qui lui sont imposées. Ses mots répondent à ceux de son ami, Hugues de Floreffe, le religieux. On voit ainsi comment la singularité de Juette est perçue par le monde qui l’entoure. On entend, puis l’on voit son évolution, de l’enfant à la femme en souffrance, de la femme en souffrance à la femme en révolte.
L’amour qui la lie à Hugues de Floreffe, désincarné et passionné donne lieu à des pages magnifiques, des cris d’amour qui tordent les entrailles.
A toutes les étapes de sa vie, Juette fait preuve d’une foi qui peut paraître abstraite aujourd’hui. Elle la vit dans toutes ses fibres, dans tous les instants de sa vie. C’est à cause de cette foi que Juette refuse le mariage, le contact des hommes. Elle se veut pure comme la Vierge, détachée du monde, proche de l’idéal évangélique. Son personnage permet de comprendre une certaine forme de foi. Cette foi peut aussi être interprétée comme un refuge contre une féminité que Juette refuse. Elle refuse son corps de femme, ses attraits, les enfants qu’elle porte. Dégoûtée par le fossé trop grand entre ses rêves d’enfant et la réalité sordide de ce mariage auquel elle est contrainte, elle ne voit dans la chair qu’un purgatoire, une épreuve qu’elle endure. Pourtant, Juette enfant est sensuelle : elle aime le monde qui l’entoure, les couleurs, les odeurs.
Sa passion est à mettre en parallèle avec celle du Christ, avec l’histoire du christianisme.
Juette revient aux sources du christianisme: service, charité, lutte contre soi, pauvreté, etc. On aperçoit à travers elle la lutte entre deux tendances de cette religion. La première, quelque peu nihiliste qui fait de la chair la première porte de l’Enfer, la seconde, officielle et déviante, qui veut la multiplication des croyants.
A travers son histoire, son refuge dans une communauté de béguines, son investissement dans le soin des lépreux, on voit aussi se dessiner un Moyen-Age où la religion est au centre de tout, où les révoltes contre le dogme prennent vie, où la répression et les heures noires des croisades s’annoncent.
Le style sec, poétique de Clara Dupont-Monod sert à merveille son roman. Son parti pris d’alterner les points de vue de l’homme et de la femme aère le texte, et lui donne à mon avis une grande profondeur. Une magnifique découverte.
« Tous les matins, je dois coudre. Ma mère m’attend dans la grande salle. Elle est assise devant le feu. Elle ignore le soleil d’automne qui trempe les pierres et tape contre les murs. Au-delà de la ville, les collines se laissent brûler le dos. Pourquoi restons-nous enfermées ? Je voudrais aller coudre sous l’arbre de la cour. Nous serions assises dans la lumière orange ? »
« Chacun encourage la barbarie. Il faut voir comme on regarde les filles seules, ou celles au ventre toujours plat. Je ne comprend pas pourquoi. J’ai cherché dans les textes. Ni Dieu, ni le Christ n’ont jamais demandé qu’on torture les filles. La Vierge est pure. Alors pourquoi ? »
Lily l'a lu, Clarabel aussi!
Clara Dupont-Monod, La passion selon Juette, Grasset, 232p.