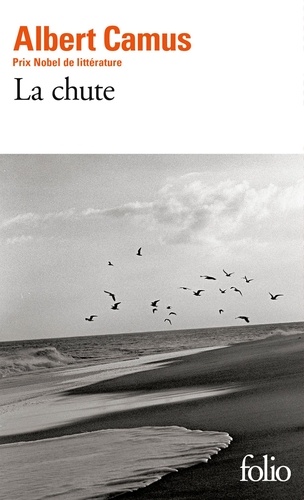Léa danse, elle se perd entre sa compagnie dont elle fête les dix ans, les tournées et ses échecs amoureux. Sa mère, elle, au fond de la Bretagne, se tait. Elle tait comme elle l'a toujours fait les blessures d'un passé qui ronge, comme une lèpre, sa vie et celle de sa fille.
Par ce silence, Romilda, la mère, a emplit d'un vide immense le coeur de sa fille. Si Léa danse, c'est parce qu'elle a peur du silence, peur de l'immobilité qui appelle la mort. Parce que bouger est le seul moyen de ne pas penser, de ne plus penser et d'écarter la souffrance. Léa danse pour fuir, mais aussi pour que son corps lui appartienne même si elle ne sait pas très bien pourquoi il lui faut cette maîtrise totale de son corps pour se sentir bien.
"Danser c'est altérer le vide.
Pourquoi inscrire un mouvement dans le rien? Elle voudrait tant pouvoir juste contempler et habiter simplement, sans bouger. Elle envie ceux qui le peuvent. Elle, elle n'y arrive pas.
Elle est un mot étranger jeté dans une langue. Comme un mot tout seul jeté dans le silence. Elle se sent intruse. Depuis toute petite.
Alors elle danse. Il faut qu'elle trace, avec son corps, les lignes qui permettent d'intégrer l'espace. Seule la beauté du mouvement peut la sauver.
C'est sa façon de trouver place dans la vie."
Mais en rencontrant Bruno, tout en immobilité, en le fuyant malgré l'amour profond qu'elle éprouve pour lui, elle comprend qu'il va falloir qu'elle aille chercher les origines de la peur qui habite les yeux de sa mère, de la violence contenue de cette italienne en exil qui a fait d'elle ce qu'elle est. C'est au coeur d'une tempête d'une rare violence que la parole va éclore.
Jolie métaphore que celle de la tempête. Cette tempête est celle qui habite Léa et sa mère, qui les dévaste le temps d'une vie avant de les laisser enfin sereines, aptes à faire face au passé et au présent. C'est dans le cocon d'une cuisine qu'elles vont enfin se parler, se découvrir l'une l'autre, au chaud, alors que le vent détruit tout à l'extérieur.
Comme dans Les demeurées, Jeanne Benameur explore les méandres des relations entre mère et fille, de la transmission. Léa et Romilda, l'une et l'autre brisées par un homme. Romilda a aimé passionnément, aimé jusqu'à se taire quand l'homme qui lui avait promis le mariage a vendu son corps au premier venu. Aimé au point de le suivre en France, de l'épouser et de donner le jour à son enfant. Romilda a aimé, mais n'a fait que survivre, habitée par la peur qu'un jour sa fille apprenne et la rejette. Une peur qu'elle lui a transmise en même temps que les gestes, la nécessité du mouvement, la fuite. Laver les ombres raconte le poison du secret, mais aussi l'amour inaltérable et immense qui peut unir une mère et sa fille.
"Elle consacre.
Son unique baptême, il est là.
Elle se reconnaît fille de.
Et cette femme-là, allongée, qui ose enfin parler, c'est sa mère."
L'écriture syncopée, sèche de l'auteur traduit à merveille l'étouffement, la peur et la douleur rentrée. La difficulté de mettre en mot la souffrance, de parler. C'est violent, moralement, et physiquement aussi, mais très beau. On lit presque sans respirer ce texte. La narration qui alterne le présent de Léa perdue dans ses souvenirs et le passé de Romilda distille petit à petit l'horreur, la compréhension des noeuds noués dans cette famille.
Laver les ombres, en photographie, c'est amener des visages à la lumière. Là, c'est passer à l'âge adulte en regardant en pleine lumière ceux qui nous entourent. Quand Romilda met enfin des mots sur son passé, Léa quitte l'enfance, apprend, à défaut de comprendre, que son père, comme sa mère ont été des individus avec leurs noirceurs, leurs naïvetés, et la complexité d'un amour.
C'est beau, poignant, étouffant, très juste aussi.
"Aimer c'est juste accorder la lumière à la solitude.
Et c'est immense."
L'avis de Lily, Adlitteram, Sylire, Bellesahi, Yohan,...
Jeanne Benameur, Laver les ombres, Actes Sud, 2008 4/5