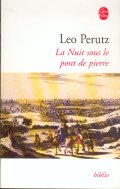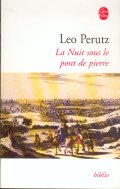
Pour la première réunion du Club des théières, le thème choisi était la nuit. J’ai donc, après moult recherches porté mon choix sur La nuit sous le pont de pierre de Léo Perutz. C’est un auteur que j’avais lu il y a fort longtemps et que j’avais envie de retrouver.
La belle Esther, épouse de Mordechai Meisel le marchand rêve, nuit après nuit, d’un amour fou et profond. Elle rêve, mais dans le ghetto de Prague, qui peut dire ce qui est rêve et ce qui est réalité ?
En 14 chapitre, 14 tableaux, Léo Perutz peint la Prague du 17e siècle. Les récits s’entrecroisent, les personnages se rencontrent, s’aiment, se déchirent, se trompent. Et progressivement, d’ellipses en détails l’histoire se dessine. Elle est celle d’un homme qui réussit, un homme a qui la richesse vient sans qu’il la recherche, un homme béni ou maudit, on ne sait guère, un juif sans qui l’empereur Rodolphe ne serait rien. Un homme dont l’unique amour le trompe sans le savoir.
C’est un roman difficile à raconter comme il l’a été à suivre. Léo Perutz décrit un monde en se reposant sur le socle solide de l’histoire, mais y instille de la truculence, du fantastique, de l’humour, de la poésie et du drame. Plus qu’un roman, on a l’impression de se retrouver devant une série de contes.
On y découvre Prague dans ses différents quartiers, son organisation sociale, ses traditions, on y découvre l’histoire d’un empire et de sa chute, on y découvre ce que pouvait être la vie de la communauté juive au 17e siècle en Europe de l’Est.
Il est beaucoup question de la vie, de la mort et du rêve dans ce récit. L’histoire d’Esther notamment montre à quel point la différence peut parfois être difficile à faire entre la vie et le rêve. Cet amour avec Rodolphe, l’empereur, qu’elle croit rêver nuit après nuit est puni comme s’il était réel, comme si elle trompait sciemment son époux. Il est puni même si elle n’en est pas responsable, jouet qu’elle est devenue d’intrigues politiques. Car c’est le rabbin qui a fait en sorte que les deux amoureux se rencontrent ainsi nuit après nuit, en enchantant un rosier et un romarin. Et qui l’a fait pour protéger sa communauté d’un empereur tombé fou amoureux de la belle Esther entraperçue une fois au détour d’une rue.
Rien n’est plus réel sous sa plume que les fantômes qui hantent le cimetière juif, rien n’est plus réel que la magie de rabbins versés dans la Kabbale.
Quand à la mort, elle est une vieille compagne qu’on retrouve de chapitres en chapitres. Qu’on l’appelle, qu’on cherche à la fuir, qu’on la provoque ou qu’on la donne, elle est présente. Elle frappe certains, en épargne d’autres, et elle frappe aussi un monde qui vit ses dernières heures et dont la destruction finale est portée à la connaissance du lecteur.
En même temps, rien de plus foisonnant que ces ruelles, ces rues, même promises à la mort, rien de plus vivant que ces palais, ces maisons, ces hommes, ces anges qui pleurent et ces fantômes qui dansent.
Ce qui sous-tend cette œuvre, c’est aussi l’union impossible de deux mondes, union symbolisée par l’amour fou et tragique de Rodolphe et Esther.
Tous les chapitres, toutes les histoires que conte Léo Perutz ne m’ont pas touchées ou plues. J’ai parfois trouvé les récits un peu longuets ou moins intéressants. Mais j’ai rêvé, j’ai ri, j’ai été émue aux larmes en le lisant. C’est un hommage superbe rendu par cet auteur à sa ville natale.
J’ai eu envie de repartir à Prague, j’ai eu envie d’en savoir plus sur l’histoire de cette ville. C’est un magnifique classique, et un bon moyen de découvrir cet auteur.
« Quand le vent du soir soufflait sous les ondes du fleuve, la fleur du romarin se blottissant un peu plus contre la rose rouge, et l’empereur qui rêvait sentait sur ses lèvres le baiser de l’amante de ses songes.
- Tu es venu fort tard, murmura-t-elle. J’étais couchée et je t’attendais. Tu m’as fait attendre bien longtemps.
- Je ne t’ai jamais quittée, répondit-il. J’étais couché et je plongeais mon regard par la fenêtre, dans la nuit, je voyais les nuages passer et j’entendais le murmure de la fontaine, j’étais si fatigué qu’il me semblait que mes yeux allaient se fermer d’eux-mêmes. Et tu es enfin venue me retrouver. »
Léo Perutz, La nuit sous le pont de pierre, Le livre de poche, 1990