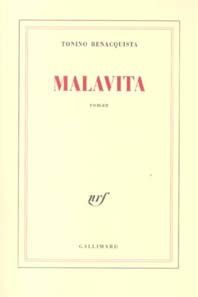 « Une famille apparemment comme les autres. Une chose est sûre, s’ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. »
« Une famille apparemment comme les autres. Une chose est sûre, s’ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. »Tonino Benacquista, Malavita, Gallimard, 2004, 314 p.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
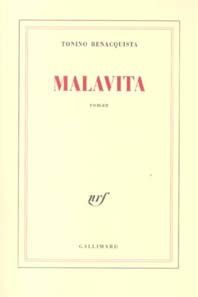 « Une famille apparemment comme les autres. Une chose est sûre, s’ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. »
« Une famille apparemment comme les autres. Une chose est sûre, s’ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. » « C’est une histoire lourde, Pavlina. Douloureuse. C’est aussi une histoire très belle. Faite d’amours fortes, de mort et de vie. »
« C’est une histoire lourde, Pavlina. Douloureuse. C’est aussi une histoire très belle. Faite d’amours fortes, de mort et de vie. »MetinArditi, La fille des Louganis, Actes Sud, 2007, 237 p.


Une jeune femme, à l'aube de son mariage, raconte la vie de sa grand-mère telle que celle-ci et son entourage la lui ont contée, la vie d'une jeune femme d'une grande beauté à la sensibilité exacerbée, à l'imagination débordante qui rencontre un jour l'écriture dans un monde rural qui supporte mal la différence.
Depuis le temps que je regardais avec envie, depuis le temps que je ne lisais que des critiques élogieuses à son sujet, depuis le temps que sa couverture m'attirait l'oeil... J'ai craqué. L'effet TGV, je pense que vous voyez ce que ça peut donner: "Oh! Je suis en avance! Oh! Le Virgin de la gare est ouvert! Oh! Je vais passer 4h coincée dans un wagon! Oh! Et si je m'offrais un bon bouquin??? Non, pas bien, j'en ai déjà trois dans mon sac.... Et puis si, y'a pas de raison!"
Tout ceci pour dire que le Mal de pierres de Milena Agus a transcendé mon trajet ferroviaire de belle manière! Pourtant, avec tout ce qui en avait été dit, je courrais le risque une fois de plus d'être déçue. Ca n'a pas été le cas, loin de là! Mal de pierres est un roman court, intense, ciselé et dur comme on imagine que peut l'être le soleil de Sardaigne sur la mer et la roche.
C'est un beau récit sur la folie, la souffrance qu'offre Milena Agus, un beau personnage de femme qui vit à côté de sa vie faute de pouvoir d'adapter au carcan étroit des valeurs de la société dans laquelle elle vit. Si on la dit folle, c'est que sa sensibilité, et sa sensualité mettent en danger la communauté et ses valeurs. Ce qui est différent ne peut être réellement accepté. Et ce qui ne peut être dit finit toujours par être exprimé par des corps qui ont mal. Le mal de pierre de l'héroïne n'est finalement que l'expression physique de ce qu'elle ne peut révéler, de son incapacité à se sentir heureuse alors que pour ceux qui l'entourent, elle a tout pour cela. Il lui manque l'essentiel, l'amour, l'amour qui se dérobe, qui refuse de venir.
L'imaginaire et sa force sont le filigrane de cette histoire. L'héroïne chute à cause de cet imaginaire, elle survit grâce à lui et fait de lui le centre de sa vie. C'est ce qui la sauve de la médiocrité des jours, de la mauvaiseté de son entourage. Elle modèle le monde et finit par brouiller ses repères et ceux des lecteurs. Où est le vrai, le réel, quelle est la part de l'invention. En sus d'une belle histoire d'amour, on a une toute aussi belle réflexion sur le vrai et l'écriture.
Le style sobre de Milena Agus rajoute au charme et à la force de l'ensemble. L'apreté du texte va de pair avec une grande tendresse pour ses personnages, principaux comme secondaires, lesquels sont étonnement précis et vivants. Elle décrit le mal-être et la douleur avec pudeur et retenue. Un beau livre.
"A partir du moment où grand-mère s'aperçut qu'elle était devenue vieille, elle me disait qu'elle avait peur de mourir. Pas de la mort en soi qui devait être comme aller dormir ou faire un voyage, mais elle savait que Dieu était fâchée contre elle parce qu'il lui avait donné plein de belles choses en ce monde et qu'elle n'avait pas réussi à être heureuse, et Dieu ne pouvait pas lui avoir pardonné ça. Au fond, elle espérait être vraiment dérangée car saine d'esprit, elle ne coupait pas à l'enfer."
De belles choses en sont dites sur Le blog des livres, chez Clarabel, Cuné, Lilly, ...
Milena Agus, Mal de pierres, Liana Levi, 2007, 123 p.

Au départ était un titre intriguant, une belle couverture et un éditeur de confiance. Puis cette histoire de condamné à mort vendant son dernier souhait à la compagnie Van Houten. A l'arrivé est cet ovni, entre roman et recueil de nouvelles que nous offre Ornela Vorpsi.
J'ai été assez destabilisée: Ornela Vorpsi commence par raconter ce qui ressemble fortement à son adolescence. C'est à travers sa relation avec une arrière grand-mère mourante qu'elle fait découvrir à son lecteur l'Albanie communiste des années 60, la dureté, voire la cruauté des relations familiales et de voisinage. Car dès le départ, ce n'est guère par amour ou par abnégation que les gens vont les uns vers les autres: si la petite-fille raconte des histoires à une son aïeule, ce n'est pas pour la rassurer ou par amour, c'est par égoïsme, par envie de croire et de faire croire à ses histoires.
Et cela va continuer. Chaque chapitre présente un personnage différent, homme, femme, adolescents. Chaque chapitre est le récit d'un échec, d'une souffrance, d'une vilénie. Ornea Vorpsi veut montrer avec chacune de ces histoires que l'homme est prêt à se vendre en toutes circonstances et pour quelque raison que ce soit. Se vendre pour gagner sa vie, se vendre pour être aimé, se vendre pour que cesse la solitude, se vendre pour immigrer. L'immigration, le déracinement est aussi un des thèmes majeurs de cette oeuvre. La plupart de ses personnages sont des migrants qui ont tout abandonné derrière eux et qui tentent de survuivre dans un ailleurs dont la réalité est bien loin des rêves d'avant. On ne découvre d'ailleurs que des anecdotes, res petits moments qui disent l'absurdité de la vie.
J'avoue n'avoir guère accroché. Pas par rejet de l'écriture de l'auteur, mais à cause de cette vision presque uniformément noire et glaçante de la nature humaine. C'est vraiment une peinture déséspérée, voire amère de relations humaines vides de sens. C'est dur, sans doute salutaire pour certains, mais cette sensation de s'enfoncer toujours plus dans la médiocrité, la méchanceté, la folie et la vanité m'a un peu agacée. Peu, voire pas d'humour. J'ai regardé par ma fenêtre, j'ai regardé les gens, et je me suis dit que le monde pouvait être beau. Et que je préférais les oeuvres qui le disent aussi.
Ornela Vorpsi, Buvez du cacao Van Houten, Actes Sud, 2005, 156 p.