 Le Nord-Est du Groenland, terre de cocagne et de bonheur pour les chasseurs, télégraphistes, et autres bonshommes hauts en couleur qui s'y sont installés et s'y consacrent à chasser l'ours, trinquer avec une boisson d'homme, se raconter des histoires, se battre et se réconcilier. Mais voilà que cette existence paisible est menacée par un infâme bureaucrate et son décret de fermeture des stations de chasse... Une réserve protégée, non mais quelle idée! Retourner à la chaleur du Danemark? Jamais! Chacun va comploter pour échapper à ce triste sort.
Le Nord-Est du Groenland, terre de cocagne et de bonheur pour les chasseurs, télégraphistes, et autres bonshommes hauts en couleur qui s'y sont installés et s'y consacrent à chasser l'ours, trinquer avec une boisson d'homme, se raconter des histoires, se battre et se réconcilier. Mais voilà que cette existence paisible est menacée par un infâme bureaucrate et son décret de fermeture des stations de chasse... Une réserve protégée, non mais quelle idée! Retourner à la chaleur du Danemark? Jamais! Chacun va comploter pour échapper à ce triste sort.
Ahhhh, les racontars de Jorn Riel, ces petites histoires drôles, tragiques, un peu fantastique, souvent extraordinaires, truculentes... Ce n'était pas ma première rencontre avec Walfred, Lasselille et les autres et j'ai été heureuse de pouvoir les retrouver et faire un bout de chemin avec eux dans ces circonstances ma foi difficile de leur existence.
Comme toujours, Jorn Riel donne libre cours à un talent de conteur d'une grande richesse et raconte, sous les dehors d'historiettes, la vie de ces hommes possédés par le Grand Nord, le choc d'un retour à la civilisation qu'aucun d'eux ne souhaite, la fin d'un monde et de traditions, des anecdotes vécues ou entendues durant la vingtaine d'années qu'il a passé dans cet univers. Du coup, il devient difficile de démêler le vrai du faux et le faux du vrai.
Ceci dit, ce n'est pas important: à travers ces histoires, Jorn Riel parle de choses universelles, d'amour, d'amitié, de deuil, de peur, de volonté de trouver sa place dans le monde, de liberté et du moteur puissant que ces sentiments sont. Il y a le Capitaine de la Vesle Mari et son naufrage haut en couleur, Doc et Mortensen qui traversent l'Islandis à vélo plutôt que de se soumettre, Lasselille qui se bat contre les esprits., Rasmussen qui doute, et les autres... tous fidèles en amitié, teigneux, têtus et tendres sous leurs abords bourrus. C'est tout un monde d'hommes attachés à leur liberté, à une existence rude et à une nature qu'ils aiment profondément que l'on parcourt. On croise au hasard de ces histoires la culture Inuit, autre thème de l'oeuvre de Riel et de romans magnifiques, des paysages sublimes que Riel sait si bien dérouler sous les yeux de son lecteur et qui donnent envie d'aller faire un tour sur les traces de ces héros et on quitte tout cela à regret.

Ce sont presque les derniers racontars. Les stations de chasse sont fermées, Doc, Mortensen, Lasselille et les autres ont trouvé une nouvelle place dans le monde, où on les devine heureux et prêts à vivre de nouvelles aventures loin de nos yeux. Longue vie à eux!

Au début du mois de juin, une rencontre avait été organisée avec Jorn Riel. J'y suis allée le coeur battant de rencontrer ce grand monsieur. J'ai découvert au fond d'un café branché un homme calme, attentif, rêveur et charmant. Dommage que l'absence de traductrice ait rendu le dialogue plus difficile, plus heurté. Mais ce fut une belle rencontre, une manière de découvrir la vie et l'oeuvre de cet écrivain hors du commun, un moment superbe à l'écouter parler de son expérience au Groenland: 20 ans d'une vie dans le Grand Nord à croiser les grandes expéditions scientifiques, à découvrir la culture inuit, à vivre avec les chasseurs, jusqu'à ne plus pouvoir supporter le Danemark. En l'écoutant, j'ai découvert à quel point ses écrits étaient imprégnés de son expérience et cela me les a rendu plus précieux encore.
Il n'y a pas de fin aux racontars a-t-il dit, il pourrait en écrire encore et toujours, raconter des morceaux de ces journées passées avec ces gens qui étaient devenus des bons amis et qui sont encore présents pour lui, aussi vivant qu'autrefois. Le Grand Nord n'est jamais sorti de son esprit, malgré son départ, les voyages et son installation en Malaisie. Il écrira un jour ses mémoires. J'ai été heureuse de l'entendre. Parce qu'une vie pareille vaut toutes les histoires et les romans, j'attendrai ces mémoires avec impatience et l'espoir de recroiser un jour la route de monsieur Riel.
Bien d'autres choses ont été dites encore au cours de cette rencontre. Je m'arrête là. Les racontars sont partis vers mon père qui m'a un jour fait découvrir ces histoires, comme bien d'autres avant.
Vanessa parle aussi de cette rencontre.
Tamara, Lounima, Lily, parlent de ces racontars. Elles ne sont pas les seules, à vous de vous promener au gré des liens. Je vous recommande les interviews de Jorn Riel au passage, elle valent le détour!
Riel, Jorn, Le naufrage de la Vesle Mari et autres racontars, Gaïa, 2009, 250p. 5/5
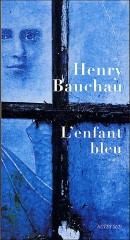 L'enfant bleu d'abord. L'histoire d'Orion, un adolescent psychotique que personne ne parvient à réellement prendre en charge jusqu'à Véronique, une psychanalyste qui lui fait trouver le chemin de l'art, un chemin qui va changer son rapport au monde et lui permettre de vivre avec le démon de Paris qui l'attaque dès que la situation dans laquelle il se trouve lui est insupportable.
L'enfant bleu d'abord. L'histoire d'Orion, un adolescent psychotique que personne ne parvient à réellement prendre en charge jusqu'à Véronique, une psychanalyste qui lui fait trouver le chemin de l'art, un chemin qui va changer son rapport au monde et lui permettre de vivre avec le démon de Paris qui l'attaque dès que la situation dans laquelle il se trouve lui est insupportable. Déluge est le miroir de L'enfant bleu. Il y avait Orion, il y a Florian, le peintre fou et pyromane dont l'habitude de brûler ses oeuvres répond à cet acte accomplit par Orion et auquel on pense forcément. Florian, c'est un peu Orion, un Orion qui aurait vieilli, dont l'art aurait connu succès et reconnaissance, qui rencontrerait sur sa route une jeune femme à sauver comme lui avait été sauvé par une femme, celle qui avait su l'écouter et l'amener à trouver dans la peinture un exutoire. Cette jeune femme c'est Florence, qui a abandonné une carrière universitaire prometteuse pour partir se soigner, et surtout se trouver et se construire elle qui n'avait fait que suivre le chemin tracé par sa mère vers le succès et la reconnaissance sociale. C'est sur les docks d'un port du Sud de la France que leurs chemins vont se croiser et s'entremêler sans qu'on sache bien qui soutient qui dans cette collaboration qui les ménera tous les deux et leur entourage avec eux vers la grande oeuvre de Florian.
Déluge est le miroir de L'enfant bleu. Il y avait Orion, il y a Florian, le peintre fou et pyromane dont l'habitude de brûler ses oeuvres répond à cet acte accomplit par Orion et auquel on pense forcément. Florian, c'est un peu Orion, un Orion qui aurait vieilli, dont l'art aurait connu succès et reconnaissance, qui rencontrerait sur sa route une jeune femme à sauver comme lui avait été sauvé par une femme, celle qui avait su l'écouter et l'amener à trouver dans la peinture un exutoire. Cette jeune femme c'est Florence, qui a abandonné une carrière universitaire prometteuse pour partir se soigner, et surtout se trouver et se construire elle qui n'avait fait que suivre le chemin tracé par sa mère vers le succès et la reconnaissance sociale. C'est sur les docks d'un port du Sud de la France que leurs chemins vont se croiser et s'entremêler sans qu'on sache bien qui soutient qui dans cette collaboration qui les ménera tous les deux et leur entourage avec eux vers la grande oeuvre de Florian.


