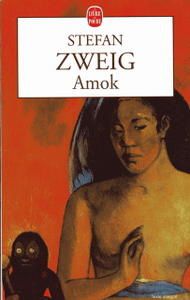Modesta naît le premier janvier 1900 dans un petit village de Sicile. Enfant d’une mère pauvre, seule et frustre, rien ne la destine à devenir une princesse. Ni la femme instruite, libre, indépendante et farouche qui va peu à peu s’affirmer.
A lire ce court résumé, on aurait presque l’impression de se trouver devant un conte de fée. Ou comment la jeune fille méritante rencontre le prince charmant qui l’arrache à sa pauvre masure. Mais Modesta n’est certainement pas une jeune fille méritante. Ou plutôt une jeune fille soumise à son destin, docile et attendant un époux pour quitter un état de dépendance pour un autre. C’est un personnage riche, dense, qui va traverser les pires années de 20e siècle avec une force de vie profonde.
Dès son enfance, son adolescence, Modesta affirme un caractère hors du commun, seul capable de lui permettre de résister au pire. Car dès le départ le pire lui est promis malgré son intelligence vive, sa sensualité déjà vivante : fille d’une pauvresse et de père inconnu, sœur d’une trisomique quand cela est encore considéré comme une punition de Dieu. Comment s’étonner dès lors qu’elle ne recule devant rien pour gagner sa liberté ?
C’est cette liberté qui est finalement le thème et le personnage principal de ce roman fleuve de 800 p. La conquête quotidienne de la liberté contre les autres, et surtout contre soi.
« En un éclair, je compris ce qu’était ce qu’on appelle le destin : une volonté inconsciente de poursuivre ce que pendant des années on nous a insinué, imposé, répété être le seul juste chemin à suivre. »
Pour elle, ce destin aurait du être celui d’une femme pauvre, d’une épouse soumise, d’une mère forcément aimante, ou d’une religieuse. Tout ce vers quoi la renvoyaient les hommes, certes, mais surtout les femmes, le rempart le plus sûr du conformisme social, les bourreaux les plus convaincus de leurs propres soeurs.
Ce n’est pas le seul conformisme, contre lequel se bat Modesta. On peut dire de ce personnage qu’il est la quintessence des convictions de Goliarda Sapienza : petite-fille de syndicalistes, née d’un père chef de fil du socialisme sicilien et d’une mère première femme à diriger la Chambre du travail de Turin.
Autour de Modesta/Liberté gravitent une galerie de personnages qui représentent tous un état de la société, ou un idéal. De Tuzzu le paysan à Carlo le médecin communiste en passant par Nina l’anarchiste et Joyce l’intellectuelle, on voit se dessiner en filigrane du récit des modes de vie opposés, des idéaux et des idéologies que la jeune femme va apprendre à connaître, accepter ou fuir, en tout cas toujours critiquer avec une lucidité parfois douloureuse.
« Mais l’amour n’est pas absolu et pas davantage éternel, et il n’y a pas seulement de l’amour entre un homme et une femme, éventuellement consacré. On peut aimer un homme, une femme, un arbre, et peut-être même un âne, comme le dit Shakespeare. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le Mot amour mentait, exactement comme le mot mort. Beaucoup de mots mentaient. Ils mentaient presque tous. Voilà ce que je devais faire : étudier les mots exactement comme on étudie las plantes, les animaux… Et puis, les nettoyer de la moisissure, les délivrer des incrustations des siècles de tradition, en inventer de nouveaux, et surtout écarter pour ne plus m’en servir, ceux que l’usage quotidien emploie avec le plus de fréquence, les plus pourris, comme : sublime, devoir, tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. »
Telle va être la règle que Modesta va appliquer tout au long de sa longue vie, quelque soit le prix à payer pour cela.
« Ne jamais refuser de voir les côtés désagréables de la vie ; quand on ne la connaît pas, la réalité leur fait prendre des proportions gigantesques dans l’imagination, les transformant en cauchemars incontrôlables. »
A travers ce personnage hors du commun, Goliarda Sapienza aborde bien des thèmes peu usités dont le moindre n’est pas la sexualité féminine. Dès son enfance, Modesta est ce démon que combat l’Eglise, cette hystérique traitée par la psychanalyse des débuts. Une femme profondément sensuelle, qui apprend à être à l’écoute de son corps et de ses désirs, que ces désirs la portent vers un homme ou une femme. Goliarda Sapienza analyse ces désirs, analyse la sexualité et la culpabilité dont elle a été empreinte et livre à ses lecteurs des lignes d’une pertinence qui laisse rêveur.
« La vérité, c’est que quand tu trouves la femme ou l’homme qu’il te faut, alors il faut absolument arriver à s’entendre. Le corps est un instrument délicat, plus qu’une guitare, et plu tu l’étudies et plus tu l’accordes à l’autre, plus le son devient parfait et fort le plaisir. »
Une pertinence que l’on retrouve quand elle aborde des thèmes comme l’éducation des enfants, la politique, la religion, l’économie même. Une pertinence qu’elle acquiert sans doute en portant le même regard sur tout ses personnages, quelques soient leurs choix et leur sexe. Et en faisant de Modesta un personnage qui réfléchit. Important quand on y pense non ? Cette femme ne se contente pas d’accepter comme parole d’évangile ce qu’on lui dit, ce qu’elle lit. Elle l’analyse au regard de ses propres aspirations, et n’utilise que ce qui lui est utile, refusant toute aliénation et surtout, celle de la pensée et des idéaux. Il lui arrive de se tromper bien sûr, d’adhérer puis de quitter, mais ce n’est finalement qu’une manière de construire un système de pensée cohérent, son système de pensée. Un art de vivre précieux, je dirais même un objectif à atteindre.
Après ce long bavardage sur le fond du roman quid de la forme ? Non, je vais tout de même essayer de l’aborder, même brièvement !
L’art de la joie et un roman fleuve, dense, débordant de vie, mais parfois confus. La faute à l’usage de la langue que fait Goliarda Sapienza sans doute. Elle n’hésite pas à mêler langue classique et dialectes siciliens ou romains, langage médical et populaire ! Et surtout, elle heurte les temporalités : de longues pages sur un court instant, de longues périodes décrites en quelques lignes. Un moyen de rendre la psyché de Modesta sans doute, mais qui rend de temps en temps difficile la compréhension du récit. J’ai d’ailleurs eu du mal à rentrer dans cette lecture, au point d’avoir manqué de refermer le roman au bout de quelques pages. Je suis heureuse d’avoir persisté. Modesta n’est pas un personnage que l’on oublie facilement. Et elle donne une formidable leçon de vie.
« Le soleil levant m’envahit le cerveau, serein, comme libéré d’un poids d’angoisse qui depuis des mois et des mois me faisait tressaillir à la moindre ombre, au moindre bruit, et un calme jamais éprouvé m’envahit. J’ai envie de sortir, de courir dans ce soleil joyeux qui répète : tu es libre. Douceur de ne plus attendre, de ne plus dépendre d’une autre volonté. Personne ne m’enlèvera plus cette douceur, Mattia. »
« Je n’ai pas tremblé comme je le craignais, et maintenant je sais la raison de ma sérénité devant Pietro mort, devant la maladie de Prando. Ce n’est pas de l’indifférence, un émoussement des sens dû aux années comme je l’avais soupçonné. C’est la pleine possession de mes émotions et la connaissance suprême de chaque instant précieux que la vie nous offre en prime si on a fermeté et courage. »
L’avis de Sylvie qui donne en prime un grand nombre de liens !




 Nana a deux amants. Elle est aussi friande de leurs baisers que de leurs bons petits plats. Et lorsque les deux hommes se rendent compte qu’ils sont non seulement voisins de palier mais rivaux, ils vont rivaliser de talent pour gagner sa préférence.
Nana a deux amants. Elle est aussi friande de leurs baisers que de leurs bons petits plats. Et lorsque les deux hommes se rendent compte qu’ils sont non seulement voisins de palier mais rivaux, ils vont rivaliser de talent pour gagner sa préférence.