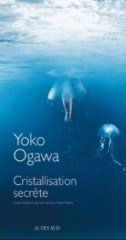 Sur une île, les choses disparaissent petit à petit, au fil des décisions d’une mystérieuse autorité. Les choses, les êtres vivants s’effacent, et avec eux les émotions, et les souvenirs qui y sont liés. Restent quelques uns dont la mémoire résiste et qui sont traqués. Reste une résistance quotidienne et peut-être illusoire à ces disparitions que certains tentent de tenir. Mais quel espoir reste-t-il quand un matin c’est votre corps même qui commence à s’effacer ?
Sur une île, les choses disparaissent petit à petit, au fil des décisions d’une mystérieuse autorité. Les choses, les êtres vivants s’effacent, et avec eux les émotions, et les souvenirs qui y sont liés. Restent quelques uns dont la mémoire résiste et qui sont traqués. Reste une résistance quotidienne et peut-être illusoire à ces disparitions que certains tentent de tenir. Mais quel espoir reste-t-il quand un matin c’est votre corps même qui commence à s’effacer ?
Yoko Ogawa est une grande plume et elle le confirme de romans en romans. Loin de la veine de La marche de Mina, ou même de La chambre hexagonale, elle a décidé, cette fois-ci, d’explorer les arcanes des tyrannies en un récit angoissant et parfois même étouffant aux accents fantastiques. La voix de la narratrice raconte les disparitions progressives, et surtout, avec une sorte de résignation, l’effacement des souvenirs, des goûts, des émotions associés aux choses et aux êtres. Ce sont les objets du quotidien dont on apprend à se passer, ce sont les oiseaux qui cessent de chanter et de traverser le ciel de l’île, ce sont les fleurs qui s’évanouissent, puis les photographies, puis la capacité à se souvenir. A chaque disparition un nouvel équilibre se crée et le cœur des hommes se creuse un peu plus. Ce processus, acceptation, rééquilibrage, Yoko Ogawa excelle à le faire percevoir ce processus à son lecteur.
Mais si elle semble se résigner, son héroïne réfléchit, s’angoisse, résiste à sa manière, suivant l’exemple de sa mère disparue pour avoir conservé les objets interdits et disparus. Parce qu’elle a conscience de la stérilité qui menace la société dans laquelle elle vit et qu'elle écrit, qu'elle lit, qu'elle se souvient des objets merveilleux que lui montrait sa mère.
« Si on ne peut pas boucher les trous des disparitions, l’île va finir par être pleine de cavités. »
Sur cette île, dont on ne saura pas où elle se trouve, s'exerce un pouvoir qui présente toutes les caractéristiques du totalitarisme: la fermeture au monde extérieure, l’élimination de tout ce qui est ressenti comme une menace, à commencer par ceux qui ne rentrent pas dans le cadre et en finissant par se retourner par l’ensemble des individus constituant la société, dans une logique absurde et glaçante, le contrôle de ce qui est pensé, ressenti... Yoko Ogawa crée un univers d'autant plus terrifiant que l'on parvient pas à en comprendre la logique. On se demande à chaque page quelle est la logique de ce pouvoir qui s’exerce : aucune sans doute, ou en tout cas le lecteur n’en aura pas connaissance. Après tout, cela n’a pas d’importance. Quelques soient les raisons, le résultat est le même.A l'image des totalitarismes qui se détruisent eux-mêmes en détruisant l’objet de leur domination dans un fonctionnement certes cohérent mais profondément absurde. Tout y est, et surtout les mécanismes de contrôle qui sont au centre du récit : les arrestations, les contrôles arbitraires et terrifiants, le mystère entretenu sur le sort de ceux qui sont arrêtés, l’utilisation de la génétique et des techniques qui en sont dérivées. C'est effrayant parce qu’inscrit dans une réalité qui est historique, mais qui est aussi la notre aujourd’hui et parce que Yoko Ogawa ne se contente pas de décrypter un fonctionnement administratif et politique. Elle explore aussi cet aspect de la nature humaine qui pousse à tout accepter pour survivre, à plier l’échine, voire à participer activement.
A côté de cela, il est question du rôle de l’art et des artistes dans la résistance, de l’importance des mots. La narratrice est un écrivain qui raconte des histoires de disparitions, autour d’elle un éditeur, le fantôme de sa mère sculptrice… Dans leur quotidien, il y a les bibliothèques désertées, les librairies exsangues, la mort de l’art et donc de la capacité de réflechir sur le monde, de s'interroger, de ressentir. Yoko Ogawa ponctue son récit d’extraits du roman qu’est en train d’écrire la narratrice, récit tout aussi terrifiant que ce qui se déroule sur l’île. Une jeune femme perd sa voix, volée par un homme qui en fait ainsi un objet qu’il peut contrôler.
« Savez-vous que si l’on sectionne ses antennes, un insecte se tient aussitôt tranquille ? Effrayé, il reste tapis et finit même par ne plus se nourrir. »
La résonance avec le quotidien de l’île est évidente et joue parfaitement son rôle de contrepoint. Petit à petit, tout ce qui fait qu’un être humain est un être humain est effacé : mots, mémoire, émotions, mots qui traduisent et permettent de communiquer, livres et objets qui conservent la mémoire de ce qui a été. Mémoire qui est un des thèmes centraux du texte dans son importance, ses troubles, sa disparition.
« Mes souvenirs ne sont jamais détruits définitivement comme s’ils avaient été déracinés. Même s’ils ont l’air d’avoir disparu, il en reste des réminiscence quelque part. Comme des petites graines. Si la pluie vient à tomber dessus, elles germent à nouveau. Et en plus, même si les souvenirs ne sont plu là, il arrive que le cœur en garde quelque chose. Un tremblement, une larme, vous voyer ?
Il parlait en choisissant soigneusement ses mots. Comme si, avant de les prononcer, il pesait un à un sur sa langue ceux qui lui venaient à l’esprit.
- J’imagine parfois ce qu’il adviendrait si je pouvais prendre votre cœur entre mes mains pour l’observer, ai-je dit. Il tiendrait tout juste sur ma paume et aurait un peu la consistance de gélatine mal prise. Il menacerait de s’effondrer à la moindre manipulation brutale, mais glisserait et tomberait si je ne le serrais pas suffisamment fort, de sorte que je tendrais prudemment les mains. Une autre particularité importante serait sa tiédeur. Puisqu’il aurait été dissimulé quelque part au fond du corps, il serait un peu plus chaud que la normale. Je fermerais les yeux pour apprécier sa tiédeur qui émanerait de partout. Alors, la sensation des choses perdues reviendrait petit à petit. Je pourrais sentir sur ma paume les souvenirs qui sont restés en vous. Vous ne trouvez pas que ce serait merveilleux ?
- Vous avez envie de vous rappeler les choses perdues ? Questionna-t-il à son tour.
- Je ne sais pas très bien, répondis-je franchement. Parce que je ne sais même pas ce qu’il vaudrait mieux que je me remémore. Les disparitions sont totales. Il n’en reste même pas de graine. Il ne reste plus qu’à essayer de s’en sortir au mieux avec un cœur desséché, plein de lacunes. C’est pourquoi j’aspire à cette sensation gélatineuse. A ce cœur qui offre une certaine résistance, qui donne la fausse impression de laisser voir son intérieur en transparence, qui lorsqu’on l’xpose à la lumière, prend toutes sortes d’expressions différentes. »
Ces récits imbriqués, miroirs l’un de l’autre sont une superbe parabole de l’effet des dictatures, tyrannies, totalitarismes. Ils sont aussi une très belle réflexion sur ce qui fait l’humanité et les conséquences de la disparition de cela. Yoko Ogawa livre un roman terrifiant, porté par ce style à la fois distant et totalement impliqué qui est le sien qui touche au cœur et par ces personnages si vivants et attachants qu’elle sait faire vivre. Il y a à la fois la douceur et la tendresse de la vie quotidienne, des liens affectifs et amicaux, et l’horreur pleine et entière au détour d’une rue ou d’une minute écoulée. Elle réussit le tour de force d’accorder à la perfection un réalisme cru, une poésie intense et un univers onirique et fantastique affirmé. Tout simplement un grand roman et un coup de cœur.
L'avis d'Emeraude.
Yoko Ogawa, Cristallisation secrète, Actes Sud, 2009, 341 p. 5/5
 **
**