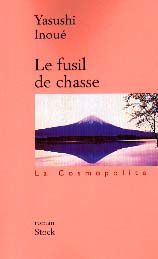Une auberge étrange dans laquelle des vieillards viennent passer la nuit auprès de jeunes femmes endormies sous l'effet d'un puissant somnifère. Pour l'un de ces vieils hommes, Eguchi, ces nuits sont un moyen de se souvenir et de méditer sur la mort et la vieillesse.
Les belles endomies est considéré comme le chef-d'oeuvre de Yasunari Kawabata, ce que je serais bien en peine de contester, faute d'avoir lu toutes les oeuvres du Nobel de littérature 1968. Reste la fascination qu'exerce ce court roman jusque dans la répétition des événements, des gestes, des mots et des pensées de son personnage principal, Eguchi. Pour ce vieil esthète et amoureux des femmes, les nuits passées auprès de ces étranges prostituées sont l'occasion de méditer sur la vieillesse dans tous ses aspects, sur la déshumanisation qu'elle provoque. Les hommes qui fréquentent l'auberge la voient comme un moyen d'approcher sans honte ni remords ce que la vieillesse leur interdit: la beauté, la vitalité. En quelque sorte, ils se conduisent comme des vampires profitant de la jeunesse, aspirant les forces des jeunes femmes endormies par un puissant somnifère. Eguchi, lui, tout en fréquentant la chambre aux tentures de velours rouge, refuse de céder à cette tentation. Il médite, lutte contre ses désirs et ses pulsions de violence, se remémore les aventures charnelles de sa jeunesse, les événements qui ont marqué sa vie d'époux et de père.
Si lui est encore capable de désir et d'assouvissement de ce désir, les autres vieillards ne le sont plus. Ils sont réduits à faire de leurs proies des objets inanimés sur lesquels projeter un désir sans issue, des mortes. C'est en tout cas, ce que nous dit Eguchi de ces autres vieillards. Ne viennent-ils effectivement que pour assouvir leurs pulsions, ou ressent-ils les mêmes sensations qu'Eguchi, soigneusement dissimulées sous le voile de conversations lubriques? Cela le lecteur ne le saura pas. Peut-être le mépris que ressent Eguchi pour eux n'est-il que celui qu'il ressent pour lui-même et ce qu'il sait qu'il va devenir.
A toutes les pages, c'est un long cri d'admiration pour la beauté des femmes que livre Kawabata, beauté physique de la jeunesse, certes, mais aussi de l'esprit. Et prise de conscience de l'aliénation que les hommes font peser sur elles. Face aux belles endormies, Eguchi se souvient de toutes les femmes qui l'ont forgé: mère, épouse, amantes, filles, encore si vivantes pour lui que la simple texture d'une peau, une simple odeur les refont vivre en lui. En leur faisant face, Eguchi se prépare à faire face à sa mort. Et ressent toute la frustration de l'absence de communication possible, seul moyen d'établir une relation véritable.
C'est un roman étrange, fascinant, sensuel, qui trotte longtemps en tête.
L'avis d'Allie, de Bartelby, de Praline, de Dominique.
Yasuniari Kawabata, Les belles endormies, Le livre de poche, coll. Biblio 4/5
 Arrivé à la cinquantaine, Oki décide d’aller écouter les cloches du nouvel an sonner à Kyoto. Là-bas vit Otoko, celle qui, à l’âge de 16 ans, a été sa maîtresse. Devenue un peintre renommé, celle-ci vit seule avec une élève, Keiko. Une élève diaboliquement belle. Une élève qui va décider de venger ce qu’a subit son maître quand bien même, celle-ci ne le désirerait pas.
Arrivé à la cinquantaine, Oki décide d’aller écouter les cloches du nouvel an sonner à Kyoto. Là-bas vit Otoko, celle qui, à l’âge de 16 ans, a été sa maîtresse. Devenue un peintre renommé, celle-ci vit seule avec une élève, Keiko. Une élève diaboliquement belle. Une élève qui va décider de venger ce qu’a subit son maître quand bien même, celle-ci ne le désirerait pas.